Le Théâtre de Carouge : renaissance architecturale d’un emblème culturel genevois
Inauguré en 2021 après une reconstruction complète par le bureau Pont12, le Théâtre de Carouge incarne la fusion harmonieuse entre patrimoine historique et modernité fonctionnelle.

Fondé en 1958 par François Simon, Philippe Mentha et Louis Gaulis, le Théâtre de Carouge est depuis son origine un lieu de création. Initialement logé dans des locaux provisoires rue Jacques-Dalphin, il s’impose rapidement comme un pilier de la scène romande, produisant des spectacles innovants. Au fil des décennies, il déploie ses activités, avec des ateliers de construction délocalisés près de l’aéroport et une petite salle louée dans une grange privée.
L’arrivée de Jean Liermier en 2008 marque un tournant. Celui-ci développe la diffusion internationale, exportant les productions en Suisse romande et au-delà. Le théâtre devient un lieu de convergence artistique, mêlant conception, répétitions et exploitation. Sa reconstruction en 2021, après l’exploitation d’un théâtre provisoire baptisé La Cuisine et revendu depuis à la ville de Nice, consacre son statut d’institution phare, avec 22 permanents et jusqu’à 150 collaborateurs en période de création et de tournées.
Un concours architectural pour une renaissance
En 2011, un concours international anonyme en deux tours est lancé par la Ville de Carouge pour la reconstruction du théâtre, jugé obsolète malgré sa beauté brutaliste des années 1970. Le bureau lausannois Pont12, mené par François Jolliet, l’emporte avec un projet intégrant trois salles de plain-pied : une grande salle de 468 places, une petite de 135 places et une de répétition d’une surface de 216 m2, pouvant accueillir 150 personnes. Ce choix optimise les circulations, évitant le recours à des ascenseurs pour les décors lourds.
La façade évolue avec la lumière : discrète le jour, elle se métamorphose en temple archaïque à la tombée de la nuit.
Le site compact, urbain et contraint par un parking souterrain impose un «Tetris» architectural : les volumes s’articulent comme des bâtiments au sein d’un îlot, créant des interstices évoquant les ruelles vénitiennes. La salle des fêtes adjacente est préservée, formant une quatrième entité.


La brique comme signature esthétique et urbaine
L’enveloppe extérieure, composée de 280’000 briques posées à la main, définit l’identité urbaine du théâtre. Les architectes ont étudié les couleurs, les cuissons et les épaisseurs des joints pour une intégration harmonieuse dans le quartier. La façade évolue avec la lumière : discrète le jour, elle se métamorphose en temple archaïque à la tombée de la nuit, comme si le bâtiment lui-même revêtait ses habits de lumière pour l’arrivée du public.

Le grand foyer, glissé sous le gradin, alterne béton brut, terrazzo et boiseries. À l’arrière, une cour intérieure sert de halle de montage, centre névralgique pour la construction et l’assemblage des décors avant leur arrivée sur scène.
Rédigé par le directeur technique Christophe de la Harpe, avec le concours de Jean Liermier et de l’équipe du théâtre, le cahier des charges donnait la priorité à l’organique : salles au rez-de-chaussée pour garantir la fluidité, loges chaleureuses pour les artistes, circulations claires, bureaux lumineux en open space pour l’administration. Connectés aux trois plateaux, les ateliers facilitent la production in situ.
Anecdotes et esprit du lieu
Durant le chantier, un renard s’installe, cohabitant pendant trois ans avec les équipes : il escalade les échafaudages, grignote les isolants et le ravitaillement, avant d’être relâché à l’orée d’un bois. Ses empreintes sont immortalisées dans le terrazzo doré qui se trouve près de la billetterie, accompagné d’un texte de Fabrice Melquiot sur «l’esprit du renard». Ce visiteur symbolise les énergies positives du site, chargé d’histoire théâtrale depuis 1958.
Des empreintes de renard immortalisées dans le terrazzo doré près de la billetterie.

Les trois salles, aux identités distinctes mais saines, suscitent le désir de créer chez les artistes. Jean Liermier évoque des fantômes bienveillants, qui adoubent le bâtiment. Ce supplément d’âme, qui mêle mémoire et vitalité, rend le théâtre attachant, avec un public fidèle et des équipes passionnées. Stimulant l’imaginaire, des anecdotes comme la métamorphose nocturne des briques renforcent son caractère narratif.



Transition vers un nouvel horizon
En octobre 2024, Jean Liermier a annoncé qu’il souhaitait passer le relais après 18 ans à la tête du théâtre. Nommé en février 2025 pour lui succéder, Jean Bellorini prendra ses fonctions en janvier 2027.
Possédant la triple nationalité suisse, française et italienne, Jean Bellorini a dirigé en France le Théâtre Gérard-Philipe (Centre dramatique national à Saint-Denis) puis le Théâtre National Populaire, à Villeurbanne, après s’être formé à l’école Claude Mathieu, à Paris. Metteur en scène primé de deux Molières, il revisite les classiques en y portant un regard contemporain, notamment «Karamazov» et «Histoire d’un Cid». La saison 2026-2027 sera placée sous le signe de la transition.
Jean Liermier
Directeur général du Théâtre de Carouge

À la tête du Théâtre de Carouge depuis 2008, Jean Liermier y est arrivé à un moment charnière : «Nous étions à un carrefour. L’histoire de cette institution était passionnante, mais il fallait l’inscrire dans les prochaines décennies, faute d’infrastructures pérennes et en raison de l’activité éclatée sur plusieurs sites.» Rapidement, il s’emploie à convaincre les autorités et identifie le besoin d’un cahier des charges précis pour la reconstruction, autant pour les espaces techniques que pour les synergies humaines des employés et du public.
« L’histoire de cette institution était passionnante, mais il fallait l’inscrire dans les prochaines décennies. »
Sur le plan artistique, il a fait sien l’esprit des fondateurs, qui avaient pour crédo de principalement revisiter les œuvres classiques avec un point de vue contemporain. Tous étaient animés d’une intention forte d’affirmer l’identité du «Carouge», afin de le mettre en valeur parmi le riche panel des institutions romandes et de soutenir, parfois contre vents et marées, la création romande, le public et un goût certain pour l’exigence.
François Jolliet
Architecte chez Pont12
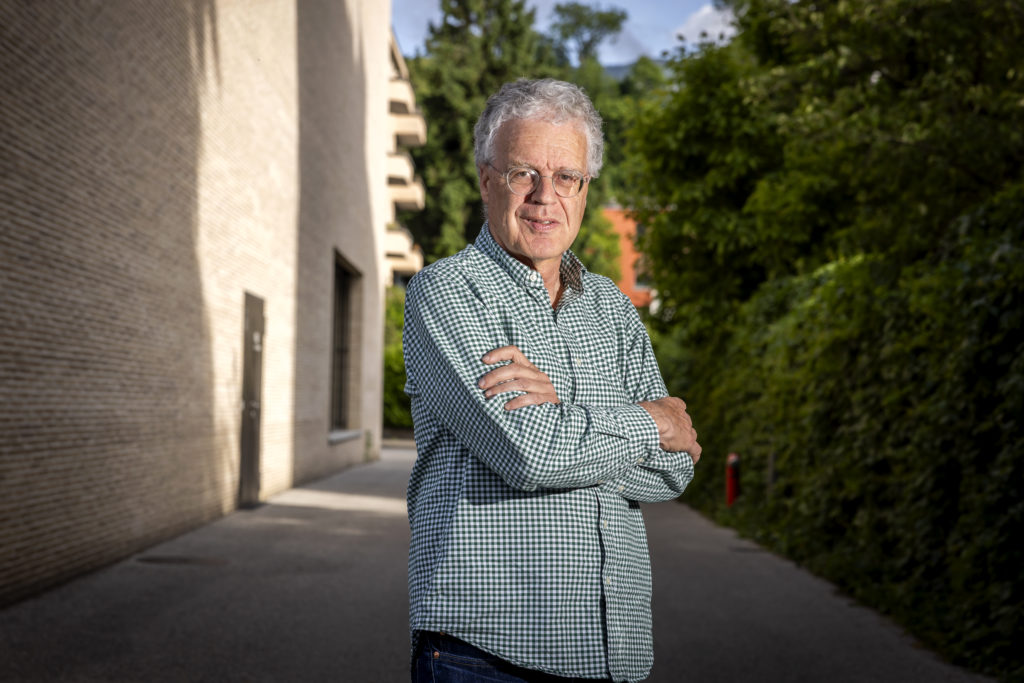
Architecte fondateur de Pont12 (avec Guy Nicollier et Antoine Hahne) et lauréat du concours de 2011, François Jolliet assume une double responsabilité : préserver l’esprit du Théâtre de Carouge, tout en l’ouvrant à de nouvelles dynamiques. «C’est un lieu exigeant, souligne-t-il. Compact, urbain, précieux. Chaque intervention doit être justifiée, respectueuse, réfléchie. Mais cela n’empêche pas l’audace.» Dernier chantier en date, la reconstruction intégrale, longtemps envisagée comme une simple rénovation : «On a décidé de lui redonner sa fonction d’origine, celle d’un espace de création permanent.»
En cours de conception, une surprise attend l’équipe : il lui faut recouvrir le nouveau bâtiment de 280’000 briques afin que celui-ci soit en fusion avec le quartier. «C’était un moment fort. Voir émerger un langage matériel ancien, adapté au moderne, c’est une forme de résurrection», note François Jolliet. Cette opération a été menée en étroite collaboration avec Jean Liermier : «Chaque geste est contrôlé, accompagné. On dialogue en permanence avec les experts, les historiens, les artisans. C’est un travail collectif.» L’attention portée à chaque détail permet de maintenir l’âme du lieu, sans jamais figer sa lecture. C’est une architecture ouverte, capable d’accueillir des usages en évolution.
« C’est un lieu exigeant, compact, urbain, précieux. Chaque intervention doit être justifiée, respectueuse, réfléchie. Mais cela n’empêche pas l’audace. »
Pour François Jolliet, la conception est avant tout un acte d’écoute : «Il ne s’agit pas de figer un bâtiment dans une époque donnée. Il s’agit de retrouver son esprit, de réactiver ses intentions, de prolonger sa vocation.» Ce souci de cohérence traverse toutes les actions menées dans le cadre de son projet : «On essaie de faire les choses bien. Pas de travestir, pas de plaquer une esthétique. Mais d’intervenir avec honnêteté.» Le théâtre est un organisme vivant : il évolue, respire, accueille. «C’est cette capacité à conjuguer passé et présent qui me touche le plus, confie-t-il. On est dans un lieu qui a une âme, une mémoire, mais aussi une énergie. Et c’est à nous de l’entretenir.»
François Jolliet a également travaillé comme acteur et scénographe au Théâtre Onze, connu dans les années 1970-1980 pour ses spectacles engagés, en immersion avec le public.
En cours de conception, la brique s’impose pour l’habillage des grands volumes pleins du bâtiment. «À l’instant où nous avons proposé la terre cuite, nous avons senti un soulagement chez nos interlocuteurs, ville de Carouge et utilisateurs. C’est tout à leur honneur d’avoir mis l’accent sur ces 280’000 briques au moment de s’acquitter d’une myriade de fonctions intérieures. Mais pour que ce soit vraiment le “Théâtre de Carouge”, pour que l’institution appartienne à sa ville, il fallait ce matériau, tout le monde le sentait. Et nous avons réussi à le financer sans péjorer l’outil de travail ou le budget», explique François Jolliet.
Les architectes se voient comme les porte-paroles de l’institution : «On essaie de servir le spectacle, avec une scène pratique et une salle qui plonge le public dans l’action. Ce précieux instant de l’art vivant, nous le préparons, nous le complotons même, en complicité avec les gens de théâtre.»
Christophe de la Harpe
Directeur technique du Théâtre de Carouge

Directeur technique du Théâtre de Carouge depuis 2003, à l’instigation du directeur François Rochaix, Christophe de la Harpe est arrivé à un moment clé : «On avait une institution puissante, mais très peu fonctionnelle. Des ateliers délocalisés, peu valorisés. Il fallait mettre de l’ordre, structurer, optimiser.» Rapidement, il identifie le besoin d’un cahier des charges global, autant pour les circulations que pour les espaces techniques : «On ne savait pas toujours ce qui posait des problèmes. Il fallait documenter, rendre consultable, partager.»
« On voulait que le théâtre ne soit pas un musée fermé, mais une ressource vivante. »
En 2011, Christophe de la Harpe initie avec Jean Liermier un vaste chantier architectural. Un portail fonctionnel est créé pour les flux. Des collaborations se nouent avec des entrepreneurs, des scénographes, des artistes. «On voulait que le théâtre ne soit pas un musée fermé, mais une ressource vivante», précise-t-il. Et surtout, il était nécessaire de reconnecter le lieu à ses missions d’origine. «Valoriser la technique, soutenir la création, transmettre les savoir-faire : tout cela n’a jamais cessé. Il s’agissait simplement de lui redonner des moyens», indique-t-il.
Un travail de fourmi, mené avec méthode : «Chaque espace est testé, documenté, intégré à une réflexion globale. C’est un processus long, mais essentiel.» Cette structuration progressive permet au théâtre d’élargir ses capacités, de renforcer ses partenariats et de renouer avec son rôle de plateforme technique genevoise.
«On redonne du sens à des volumes, à des circulations», affirme Christophe de la Harpe, pour qui cette démarche n’est pas un simple travail logistique : «Il y a une dimension émotionnelle très forte. On touche à l’histoire intime du théâtre. On redonne une voix à des générations de techniciens, de créateurs, d’artisans.» Et l’avenir ? «Il passe par la continuité, souligne-t-il. Consolider ce qui a été engagé, garder l’élan, maintenir cette ouverture. Le théâtre doit rester un lieu d’accueil, de projets et de curiosité.»























